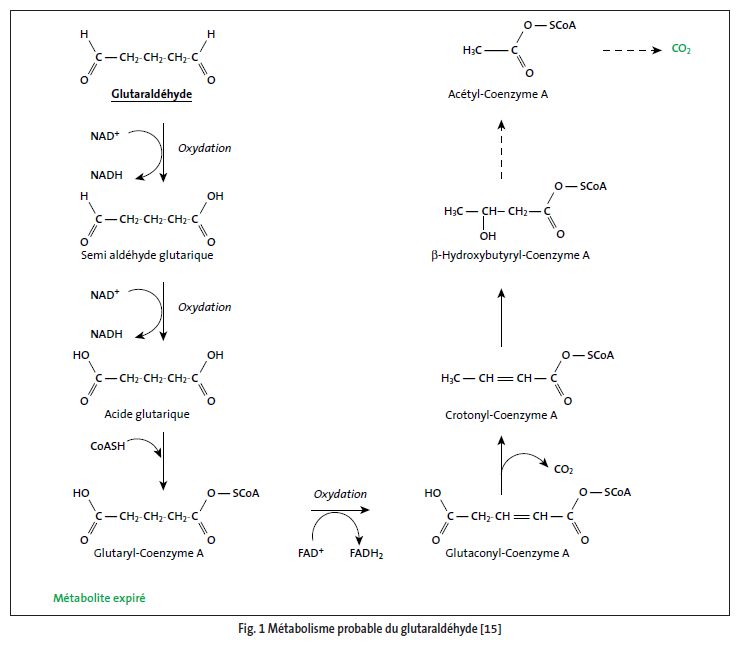La toxicité par voie orale est inversement proportionnelle à la concentration de glutaraldéhyde dans l’eau ; l’irritation du tractus gastro-intestinal induite à plus forte concentration et la tendance du glutaraldéhyde à se polymériser en présence d’eau, ce qui diminue la quantité d’aldéhyde libre actif, pourraient en être la cause. Les animaux meurent en 1 à 3 jours ; la souris semble plus sensible que le rat.
Symptômes
Les signes d’une toxicité par inhalation sont limités au tractus respiratoire et à une irritation oculaire (blépharos- pasme, larmoiements, écoulement nasal, respiration buccale et abdominale). Les vapeurs de glutaraldéhyde générées à haute température (60 °C) sont plus toxiques que celles générées à température ambiante qui n’engendrent pas de létalité chez les animaux.
Après une exposition orale, les rats présentent une pilo- érection, des croûtes péri-oculaires et péri-nasales, des mouvements ralentis, une respiration rapide et des diarrhées. À l’autopsie, on note une distension et une congestion de l’estomac avec des zones hémorragiques de la paroi, ainsi que de l’intestin grêle et un épaississement du pylore. À l’occasion, on observe également une congestion des surrénales, du foie, des reins, de la rate et des poumons.
Après exposition cutanée, des effets locaux apparaissent chez le lapin : érythème, œdème, nécrose, desquamation et escarres. Il n’y a pas de toxicité systémique chez les survivants ; à l’autopsie, on note une congestion du foie, des reins, de la rate et des poumons.
Irritation-Sensibilisation
Les solutions à plus de 10 % de glutaraldéhyde sont irritantes pour la peau du lapin, provoquant érythème, œdème et nécrose disséminée ; celles à 45 ou 50 % provoquent une inflammation locale sévère avec desquamation et nécrose.
Les solutions à plus de 1 % de glutaraldéhyde provoquent, chez le lapin, des lésions cornéennes qui s’amplifient avec la concentration ; l’inflammation de la conjonctive apparaît à la concentration de 0,2 %.
Chez la souris, le glutaraldéhyde induit une irritation respiratoire (RD50 = 13,9 ppm). Ce n’est pas un irritant respiratoire chez le cobaye.
C’est également un sensibilisant cutané chez l’animal (test du gonflement de l’oreille et test du ganglion local chez la souris, test de maximisation chez le cobaye et la souris) ; il augmente, chez la souris, le taux des cytokines spécifiques d’une réponse allergique humorale et, à des concentrations > 10 %, le taux d’IgE.
| Voie | Espèce | DL50/CL50 | Solution dans l’eau à : |
| Inhalatoire | Rat | 0,1-0,8 mg/l/4 h (24-192 ppm) Vapeurs : 96 (mâles) - 154 (femelles) mg/m3 Aérosol : 350 (mâles) - 280 (femelles) mg/m3 | |
| | | 605-735 mg/kg | 45-50 % |
| | Rat | 409-500 mg/kg | 25 % |
| | | 99-183 mg/kg | 1-15 % |
| Orale | Souris | 325-352 mg/kg 110-130 mg/kg | 25 % 2 % |
| | Lapin | 125 mg/kg | 25 % |
| | Cobaye | 50 mg/kg | ? |
| | Rat | > 2000 mg/kg | |
| Cutanée | Souris | > 5840 mg/kg | |
| | Lapin | 897-1432 mg/kg | 45-50 % |
| | 2128-3045 mg/kg | 25 % |
Tableau 2. DL50, CL50 [1, 3]
Des rats et des souris ont été exposés au glutaraldéhyde par inhalation :
- pendant 2 semaines (0 - 0,16 - 0,5 - 1,6 - 5 - 16 ppm, 6 h/j, 5 j/sem.) : les deux plus fortes concentrations sont létales pour les deux espèces, les animaux meurent en détresse respiratoire. À l’autopsie, on observe nécrose, inflammation et métaplasie squameuse au niveau du nez et du larynx ; aux plus fortes concentrations, des lésions semblables sont présentes dans la trachée et, chez le rat, dans les poumons et sur la langue.
- pendant 13 semaines (0 - 0,0625 - 0,125 - 0,250 - 0,51 ppm, 6 h/j, 5 j/sem.) : la plus forte concentration est létale pour la souris. Chez le rat, en dehors d’une perte de poids et d’une dyspnée, aucun signe clinique n’est observé. À l’autopsie, les lésions du tractus respiratoire sont semblables à celles observées lors de l’exposition pendant 2 semaines : lésions de l’épithélium respiratoire et olfactif chez le rat (NOAEL 0,125 ppm), métaplasie squameuse modérée de l’épithélium du larynx et des cornets du nez et inflammation suppurante de la partie antérieure de la cavité nasale chez la souris à 1 ppm, nécrose et inflammation aux concentrations inférieures.
- pendant 104 semaines (rats 0 à 0,75 ppm, souris 0 à 0,25 ppm, 6 h/j, 5 j/sem.) : les résultats sont semblables à ceux obtenus lors d’une exposition pendant 13 semaines.
Des rats, exposés dans l’eau de boisson (0 - 50 - 250 - 1000 ppm, soit 0 - 4 - 17 - 64 mg/kg/j pour les mâles et 0 - 6 - 25 - 86 mg/kg/j pour les femelles) pendant 104 semaines, présentent une réduction de la prise de poids, de nourriture et de boisson, avec pour conséquence une diminution du volume urinaire et du poids des reins et une irritation gastrique à la forte dose. Des observations identiques ont été faites chez la souris (jusqu’à 1000 ppm) et le chien (jusqu’à 250 ppm).
Une exposition par voie cutanée n’induit, chez le rat (50 - 100 - 150 mg/kg/j, 26 j), qu’une irritation locale et une légère baisse de poids [15].
In vitro, les tests effectués avec le glutaraldéhyde ne mettent pas en évidence d’effet mutagène sur les souches bactériennes habituellement utilisées. Les études révèlent un taux faible ou nul de mutations ponctuelles, d’échange entre chromatides sœurs sur cellules ovariennes de hamster chinois ou de synthèse non programmée de l’ADN sur hépatocyte de rat.
In vivo, le glutaraldéhyde n’induit pas de mutation létale récessive liée au sexe chez la drosophile ni de mutation létale dominante chez la souris. Il n’est pas clastogène (pas de micronoyaux ou d’aberrations chromosomiques) chez le rat ou la souris.
Les expositions à long terme n’ont pas montré d’effet du glutaraldéhyde sur l’appareil reproducteur des animaux. Dans le test de létalité dominante chez la souris, il n’y a pas de réduction de fertilité ou de modification de la viabilité embryonnaire.
Dans une étude chez le rat, sur deux générations (50 - 100 - 250 ppm), le glutaraldéhyde ne provoque pas d’effet sur la reproduction malgré une baisse du poids parental.
Des souris et des rats ont reçu, du 6e au 15e jour de gestation, entre 16 et 100 mg/kg/j. À 50 et 100 mg/kg/j, on note des signes d’intoxication chez les femelles gestantes et dans les portées. Il n’y a pas de fœtotoxicité aux doses non toxiques pour les mères.
Des lapins gavés avec 5 - 15 - 45 mg/kg/j du 7e au 19e jour de gestation présentent une toxicité maternelle et fœtale à la plus forte dose mais pas de malformation. Les NOAELs maternelle et fœtale sont de 15 mg/kg/j.