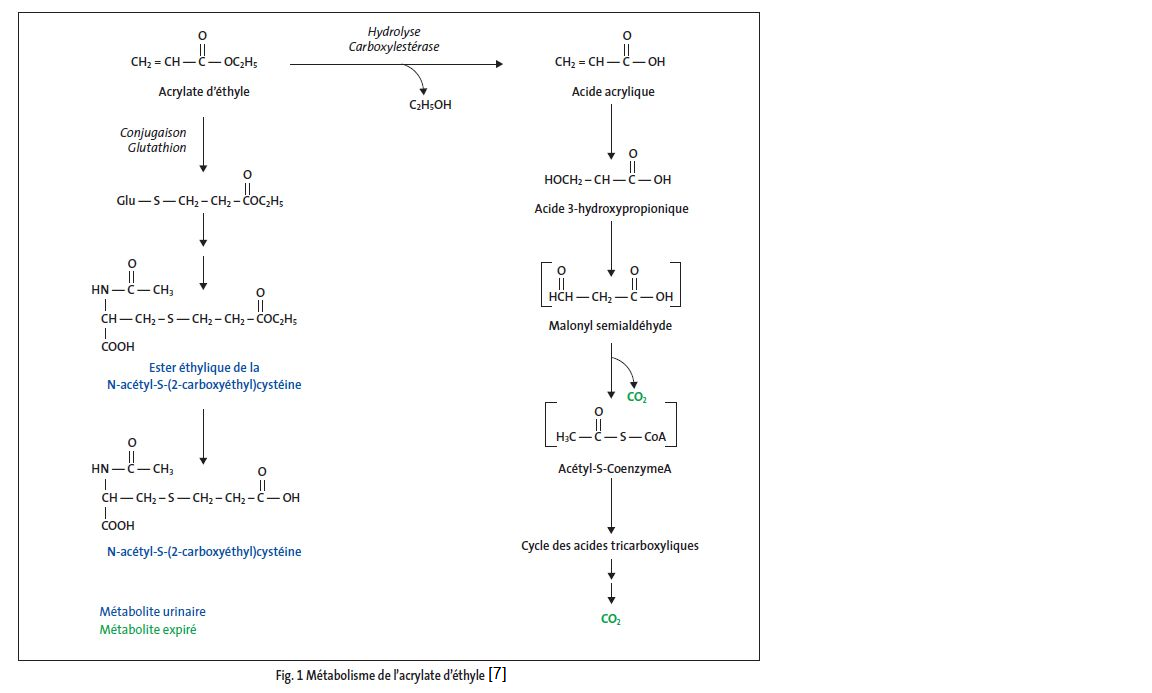Toxicité aiguë [7]
L’acrylate d’éthyle est faiblement toxique par voies orale et cutanée, et modérément toxique par inhalation ; on observe des effets irritants locaux et corrosifs. C’est un sensibilisant cutané.
| Voie | Espèce | DL50/CL50 |
| Inhalatoire | Rat | 1414-2180 ppm/4 h |
| Inhalatoire | Souris | 4000 ppm (durée non renseignée) |
| Orale | Rat | 550-2000 mg/kg |
| Orale | Souris | 1300-1800 mg/kg |
| Orale | Lapin | 370-1800 mg/kg |
| Cutanée | Rat-Souris | 200-5000 mg/kg occlusif > 5000 mg/kg non occlusif |
| Cutanée | Lapin | 1800-2000 mg/kg non occlusif |
Tableau I. Toxicité aiguë de l'acrylate d'éthyle [7, 8]
Symptômes
L’action principale de l’acrylate d’éthyle, quelle que soit la voie, est une irritation locale :
- une exposition par voie orale provoque, chez le rat, irritation gastrique sévère, prostration et narcose, et chez le lapin, léthargie, tremblements, difficulté respiratoire et cyanose. Tous les animaux meurent dans les 12 heures qui suivent l’administration d’une dose létale ;
- une exposition par inhalation engendre, chez le rat, irritation du tractus respiratoire évoluant en dyspnée, irritation oculaire et cutanée, hypoactivité, ataxie, tremblements, diminution des réflexes, baisse de la fréquence respiratoire, convulsions, sédation et mort suite à une anoxie. À l’autopsie, on observe hyperémie et hémorragie des poumons ;
- une exposition par voie cutanée induit, chez le lapin, rougeurs locales, œdème, nécrose et inflammation de la peau. À l’autopsie, le cœur, le foie et les reins présentent une hyperémie et une dégénérescence tissulaire, les poumons une hyperémie et un œdème. Le rat et la souris traités sans occlusion ne présentent aucun signe de toxicité ; après traitement occlusif, les symptômes associent baisse d’activité, érythème, œdème, blanchiment de la peau et escarres.
Irritation — Sensibilisation
L’acrylate d’éthyle est irritant, même à faible dose, pour la peau, les yeux, les tractus gastro-intestinal et respiratoire (la RD50 chez la souris est 315 ml/m3, soit 1,3 mg/l pendant 5 minutes). Les effets sont limités au site de premier contact, même à forte dose. Il est sensibilisant pour le cobaye et peut réagir de façon croisée avec les autres acrylates, mais pas avec les méthacrylates.
Toxicité subchronique, chronique [4]
L’acrylate d’éthyle, en administration prolongée par voie orale, provoque des effets locaux sévères sur la muqueuse gastrique ; les animaux exposés par inhalation ne présentent pas de réponse systémique, mais uniquement une irritation locale.
Les rats exposés par gavage (0 - 2 - 10 - 20 - 50 - 100 - 200 mg/kg/j pendant 5 ou 10 jours) développent une irritation gastrique de sévérité croissante avec la dose à partir de 20 mg/kg/j. Lors d’une exposition par gavage de rats et de souris pendant 14 jours, le principal effet toxique est confiné à la muqueuse du pré-estomac (inflammation, œdème, ulcération, hyperplasie, hyperkératose), quels que soient l’espèce et le sexe, à partir de 100 mg/kg/j chez le rat et de 200 mg/kg/j chez la souris ; une dose équivalente administrée dans l’eau de boisson est considérablement moins toxique. En exposition plus longue (souris 0 - 12 - 25 - 50 - 100 mg/kg/j, rats 0 - 7 - 14 - 28 - 55 - 110 mg/kg/j pendant 103 semaines), aucun effet attribué au traitement n’a été mis en évidence.
Les animaux exposés par inhalation (rats, souris et lapins, de 0 à 300 ppm, 7 h/j, 5 j/sem, 30 jours) présentent une létalité à la forte concentration, une modification des fosses nasales (inflammation, dégénérescence, nécrose focale et métaplasie squameuse chez le rat, altérations de type squameux chez la souris), une congestion pulmonaire, des modifications des reins et du foie (congestion et tumescence) et une pigmentation excessive de la rate (rat).
Effets génotoxiques [7, 9]
L’acrylate d’éthyle est clastogène in vitro mais pas mutagène ; in vivo, il est clastogène uniquement à une dose qui peut induire une létalité.
In vitro, l’acrylate d’éthyle n’est pas mutagène pour les bactéries dans le test d’Ames ni pour les cellules de mammifère (cellules ovariennes de hamster chinois). Il est clastogène pour les cellules de lymphome de souris (induction de petites colonies mutantes), les cellules ovariennes de hamster chinois, les cellules pulmonaires de hamster chinois et les splénocytes isolés (induction d’aberrations chromosomiques).
In vivo, il n’induit pas de mutation létale récessive chez la drosophile ni de lésion ou d’adduits à l’ADN du pré-estomac de rat. Chez la souris, il provoque une augmentation des micronoyaux et une cytotoxicité dans la moelle osseuse à une dose égale à la DL50 (1800 mg/kg, ip) ; cet effet n’est pas observé dans quatre études à des doses allant jusqu’à 812 mg/kg, ip. Des résultats négatifs ont également été obtenus lors de la mesure des aberrations chromosomiques et des échanges entre chromatides sœurs chez la souris (125 - 250 - 500 - 1000 mg/kg, ip).
Effets cancérogènes [7, 9, 10]
L’acrylate d’éthyle est cancérogène pour l’animal (tumeurs du pré-estomac) uniquement par voie orale (gavage) ; cet effet serait lié à l’induction d’une forte irritation locale chronique. En 1999, le CIRC a confirmé le classement de l’acrylate d’éthyle dans le groupe 2B (cancérogène possible pour l’homme).
L’acrylate d’éthyle, administré par voie orale aux rats et aux souris (gavage, 0 - 100 - 200 mg/kg/j) pendant 103 semaines, provoque l’apparition de tumeurs bénignes et malignes (papillomes et carcinomes à cellules squameuses) du pré-estomac en relation avec la dose ; aucun autre symptôme n’apparaît. Un traitement minimum de 200 mg/kg/j pendant plus de 6 mois est nécessaire pour l’apparition des tumeurs ; le gavage pendant une durée plus courte provoque une hyperkératose et une hyperplasie du pré-estomac réversibles en quelques mois. En revanche, une exposition orale dans l’eau de boisson (rats, 0 - 6 - 60 - 2000 mg/l, 2 ans) n’induit aucune réponse tumorale. Dans ce cas, la dose atteignant le pré-estomac et donc l’irritation locale provoquée sont plus faibles que lors d’un gavage. Le mécanisme tumoral serait lié à une hyperplasie prolongée suite à une lésion tissulaire locale plutôt qu’à une action génotoxique.
Aucune tumeur n’est induite par une exposition cutanée (souris, 25 µl d’acrylate d’éthyle pur, 3 fois/sem pendant toute la durée de la vie) ou inhalatoire (rat et souris, 0 - 0,1 - 0,31 mg/l soit 0 - 25 - 75 ppm, 6 h/j, 5 j/sem, 27 mois).
Effets sur la reproduction [7, 10]
L’acrylate d’éthyle n’est ni embryotoxique, ni fœtotoxique, ni tératogène à des doses non toxiques pour les mères.
Fertilité
Aucune donnée n’est disponible quant à l'effet de cette substance sur la fertilité à la date de publication de cette fiche toxicologique.
Développement
L’acrylate d’éthyle n’est pas tératogène pour le rat par inhalation de concentrations allant jusqu’à la toxicité maternelle (0 - 50 - 150 ppm, 6 h/j, du 6e au 15e jour de gestation) ; à concentration non toxique pour les mères, il n’est ni embryo- ni fœtotoxique. Par voie orale (rat, 0 - 25 - 50 - 100 - 200 - 400 mg/kg/j, du 7e au 16e jour de gestation), une étude peu documentée a montré une toxicité maternelle et, chez les petits, un retard d’ossification, des côtes plus courtes ainsi que des anomalies du squelette sans relation avec la dose.