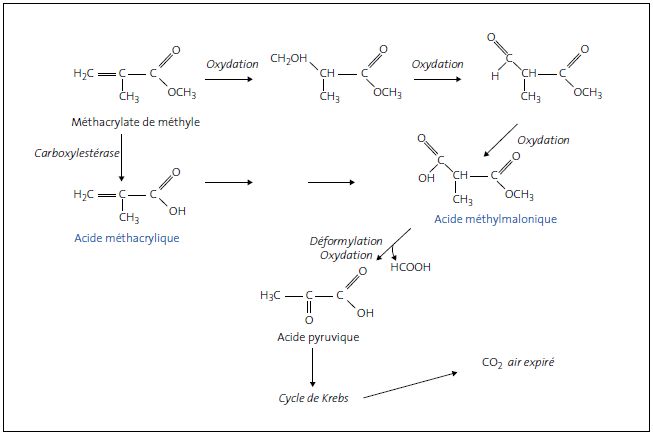Les principaux effets aigus décrits avec le méthacrylate de méthyle sont des effets irritants de la peau et des muqueuses. Lors d’expositions chroniques, des sensibilisations cutanées et des asthmes sont observés ainsi que des atteintes neurologiques. Les données actuellement disponibles chez l’homme ne permettent pas de conclure quant à une éventuelle cancérogénicité du méthacrylate de méthyle.
Toxicité aiguë
Le méthacrylate de méthyle est modérément irritant pour la peau et les muqueuses respiratoires, oculaires et nasales. Son action est moins importante que celle des acrylates de poids moléculaire inférieur [1, 4].
Des signes d'irritation cutanée (à type d'érythème ou plus rarement de brûlure) ou oculaire (à type de conjonctivite) sont décrits.
L'irritation des voies aériennes supérieures peut apparaître après 20 à 90 minutes d'une exposition à des vapeurs de méthacrylate de méthyle à partir de 50 ppm ; les effets associent toux, dyspnée et parfois signes d'intoxication systémique à type de fièvre, malaise, nausées, douleur thoracique, céphalées ou endormissement [1, 4, 29].
Des signes d'intoxication systémique plus sévères sont rapportés lors d'inhalation aiguë à des concentrations supérieures à 2000 ppm ; on observe alors une tachypnée, un œdème pulmonaire voire une dépression respiratoire.
Une baisse de la pression artérielle pouvant aller jusqu'à l'arrêt cardiaque a été décrite chez des sujets opérés pour une plastie osseuse (dont le ciment est à base de méthacrylate de méthyle) ; on peut se poser la question du rôle possible du passage sanguin direct dans l'apparition de ces effets [1, 9].
Toxicité chronique [1, 4, 9]
L'exposition cutanée répétée au méthacrylate de méthyle est faiblement irritante ; il est à l'origine de dermites d'irritation de contact, avec sécheresse cutanée plus particulièrement du dos des mains [1, 25].
De nombreux cas de sensibilisation cutanée (eczéma de contact, eczéma manuporté ou aéroporté, urticaires) confirmés par des patch-tests ont été rapportés lors d'expositions professionnelles : chez les prothésistes dentaires et dentistes notamment lors de l'utilisation de résines composites, de prothèses dentaires ou de ciments à base de méthacrylate de méthyle ; dans les professions médicales et paramédicales en particulier au contact de ciments de prothèse en orthopédie ; chez les salariés de la fabrication des plastiques durs (plexiglas par exemple) dont le méthacrylate de méthyle est le principal constituant. Parmi les différents méthacrylates, le méthacrylate de méthyle n'est pas le plus allergisant ; la fréquence de la sensibilisation cutanée dans une population de techniciens dentistes est cependant estimée à 15 %. Des allergies croisées avec d'autres méthacrylates sont possibles.
La forme la plus typique de l'eczéma de contact est la pulpite douloureuse hyperkératosique, avec souvent diminution de la sensibilité tactile au niveau de la zone de contact avec le méthacrylate de méthyle ; l'association à des paresthésies des doigts (brûlures, fourmillements, sensation de froid et de douleur) persistantes même après guérison de la dermatose est très spécifique des acrylates et en particulier du méthacrylate de méthyle [1, 24].
Des cas d'allergies cutanées ont également été observés chez des patients soit porteurs de prothèses auditives, dentaires, ou d'ongles artificiels soit ayant eu une intervention avec pose de ciment osseux à base de méthacrylate de méthyle [1].
Sur le plan respiratoire, des signes d'irritation respiratoire à type de toux sont observés par de nombreux auteurs lors d'expositions professionnelles au méthacrylate de méthyle dès 150 ppm ; ils peuvent être associés à des troubles ventilatoires obstructifs ou restrictifs chroniques (parfois isolés) aux épreuves fonctionnelles respiratoires [1, 29].
Plusieurs cas d'asthme professionnel ont été rapportés ; leur mécanisme n'est pas clairement identifié (mécanisme irritatif et/ou immuno-allergique). Les principales professions concernées sont les professions de santé (infirmières en chirurgie orthopédique, personnels dentaires et ouvriers des plastiques lors de leur usinage...) [1, 9, 23].
D'autres types d'atteintes respiratoires ont été décrits comme des obstructions bronchiques chez des ouvriers de la chimie organique ou des plastiques exposés au méthacrylate de méthyle [1, 23]. Deux cas de pneumopathie d'hypersensibilité ont été rapportés chez des étudiants en dentaire dès les premières semaines d'exposition au méthacrylate de méthyle, avec amélioration à l'arrêt de l'exposition et rechute à la reprise[26].
Sur le plan neurologique, des manifestations, le plus souvent fonctionnelles, sont rapportées dans plusieurs études chez les sujets professionnellement exposés ; elles associent irritabilité, asthénie, céphalées, malaise, nausées et vertiges, troubles du sommeil, de la concentration et de la mémoire[1].
Des anomalies olfactives proportionnelles à l'intensité et à la durée de l'exposition ont été décrites chez des ouvriers exposés à de nombreux produits chimiques dont le méthacrylate de méthyle[9].
Une atteinte neurologique périphérique, associant paresthésies, blanchiment, engourdissement et sensation de froid et de douleurs des doigts, est rapportée dans plusieurs études en particulier chez les prothésistes dentaires. Dans ces cas, la diminution des vitesses de conduction nerveuse sensitives distales, témoigne d'une dégénération axonale dans les territoires en contact avec le méthacrylate de méthyle [1, 29].
Sur le plan cardiaque, une étude russe retrouve chez des ouvriers exposés au méthacrylate de méthyle, des cardio-myodystrophies avec anomalies électrocardiographiques. Ces anomalies ne sont pas confirmées par d'autres auteurs [1, 30].
Sur le plan hépatique, une élévation discrète et transitoire des transaminases et des phosphatases alcalines a été retrouvée chez des patients ayant subi une plastie osseuse avec du méthacrylate de méthyle. Les études réalisées en milieu professionnel ne retrouvent pas d'anomalie hépatique[29].
Effets génotoxiques
Une étude ancienne conduite chez 5 travailleurs exposés au chloroprène et au méthacrylate de méthyle à des concentrations allant de 0,1 à 0,5 ppm, n'a pas retrouvé d'augmentation significative de la fréquence des aberrations chromosomiques dans les lymphocytes circulants [4, 21].
Une étude conduite chez 31 travailleurs exposés au méthacrylate de méthyle à des concentrations allant de 0,7 à 21,6 ppm, n'a pas mis en évidence d'augmentation significative de la fréquence des échanges de chromatides sœurs dans les lymphocytes circulants comparés à 31 témoins appariés sur l'âge et le tabac [1, 5].
Aucune augmentation significative de la fréquence des aberrations chromosomiques dans les lymphocytes circulants n'a été notée chez 38 hommes exposés professionnellement à des concentrations allant de 0,9 à 71,9 ppm de méthacrylate de méthyle lors de la fabrication de verres à base de polyméthacrylate de méthyle ; le nombre d'échanges de chromatides sœurs était légèrement augmenté chez les exposés comparés aux témoins, probablement en raison de l'âge plus élevé des exposés[1, 3, 5].
Effets cancérogènes
Une vaste étude de mortalité a été conduite aux États-Unis parmi 13 863 sujets exposés professionnellement à des vapeurs de méthacrylate de méthyle dans deux entreprises de fabrication de plaques acryliques entre les années 1933 et 1982. Un excès significatif de mortalité par cancer du colon est retrouvé dans la cohorte 1933 - 1945, en particulier chez les sujets les plus exposés dans les années 1940 (et non significatif dans la cohorte 1943 - 1982) ainsi qu'un excès non significatif de cancer du rectum dans la cohorte 1933 - 1945, comprenant 3934 hommes. À noter une exposition conjointe à l'acrylate d'éthyle ainsi qu'à d'autres composés volatils formés pendant le process [1, 21].
Une autre étude de mortalité a été réalisée chez 2671 hommes travaillant dans deux entreprises de fabrication de résines acryliques entre les années 1957 et 1974. Parmi 1561 exposés au méthacrylate de méthyle à des concentrations inférieures ou égales à 1 ppm, aucun excès de mortalité par cancer (et en particulier de cancers du colon) n'est noté en dehors d'un excès limité de cancers du poumon[1].
Une étude de cohorte menée aux États-Unis chez 2178 hommes ne retrouve pas d'excès de cancers du colon (SMR 1,05) ; le niveau d'exposition n'est pas connu (étude citée dans [1] et dans[9]).
Une étude de mortalité a été menée en 1995 au Royaume-Uni chez 4324 travailleurs de 2 entreprises produisant du polyméthacrylate de méthyle et exposés au méthacrylate de méthyle entre les années 1949 et 1988. La durée moyenne d'exposition est de 7,6 ans à raison en moyenne de 13,2 ppm, 8 h/jour (avec des pics pouvant atteindre 100 ppm). Aucun excès significatif de mortalité par cancer colorectal ou par cancer toutes causes confondues n'est observé, ni aucune relation avec la durée d'exposition [28].
Une revue récente de la littérature, à partir des données publiées et non publiées sur la carcinogénicité du méthacrylate de méthyle, retrouve des excès de cancers respiratoires, gastriques et colorectaux dans quelques cohortes ; la relation avec l'exposition au méthacrylate de méthyle semble peu probable pour les cancers respiratoires et gastriques en raison des facteurs de risque associés tabac et alimentation ; quant à l'excès de cancers colorectaux, observés essentiellement dans la première étude, il reste inexpliqué. Les auteurs concluent que le méthacrylate de méthyle ne peut être considéré comme un cancérogène pour l'homme et ce en raison de la non cohérence des résultats entre les différentes études et de l'absence de relation dose-réponse [27].
Effets sur la reproduction
Une étude fait état d'une augmentation statistiquement significative du nombre d'avortements spontanés précoces et tardifs chez les femmes les plus exposées et du nombre de malformations chez des enfants de mères les plus exposées au méthacrylate de méthyle entre 1976 et 1985 ; en l'absence de précision sur les conditions d'exposition et de détails sur les effets observés, il est difficile de conclure sur une éventuelle relation causale avec l'exposition au méthacrylate de méthyle[1].
Deux études russes font état d'une augmentation significative de la fréquence des troubles sexuels et des anomalies des dosages hormonaux (FSH, LH, testostérone, estradiol), réversibles 1 à 2 ans après arrêt de l'exposition, chez des hommes et des femmes exposés à des niveaux supérieurs à 5 fois la valeur limite d'exposition utilisée en URSS à cette époque (soit plus de 12 ppm de méthacrylate de méthyle) ; la fréquence des anomalies semblait proportionnelle au niveau et à la durée d'exposition[1, 31 à 33].