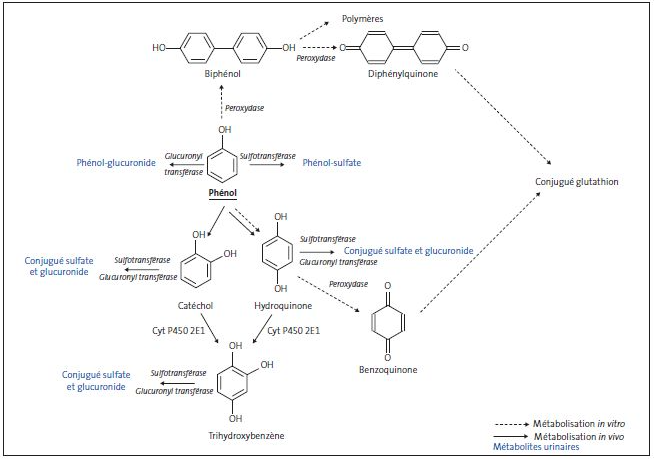Toxicité aiguë [1, 17]
En exposition aiguë, le phénol est toxique par voies orale et cutanée, irritant pour le tractus respiratoire et corrosif pour la peau.
| Voie | Espèce | DL50/CL50 |
| Orale | Rat | 340 mg/kg |
| Souris | 300 mg/kg |
| Lapin | 420 mg/kg |
| Cutanée | Rat femelle | 660-707 mg/kg (± occlusion) |
| Lapin | 850 mg/kg (± abrasion) |
| Inhalatoire | Rat | > 236 ppm (900 mg/m3) / 8 h |
Toxicité aiguë du phénol
Après inhalation, les animaux présentent une irritation nasale et oculaire et une légère perte de coordination avec spasmes musculaires et tremblements ; les symptômes disparaissent en 24 heures.
Après exposition orale à forte dose, les animaux meurent en 5 à 150 minutes. Les signes cliniques sont : variations de température corporelle, respiration ralentie et irrégulière, contraction puis dilatation des pupilles, salivation, dyspnée, tremblements, convulsions, léthargie et coma. À dose égale, la toxicité de solutions concentrées ou diluées est quasiment semblable.
De 5 à 10 minutes après exposition cutanée, les rats développent des tremblements musculaires sévères qui évoluent en convulsions, perte de conscience et prostration ; une hémoglobinurie apparaît après 45 à 90 minutes selon la dose. Tous les animaux présentent des lésions cutanées sévères avec œdème immédiat, suivi, dans les 4 heures, de nécrose et, en 24 heures, de blanchiment de la peau et d’un érythème étendu. L’autopsie révèle une congestion rénale et une distension de la vessie avec hématurie ; on observe une nécrose épidermique et dermique de la peau. La sévérité des effets cutanés est augmentée par la présence d’eau dans les solutions diluées.
Irritation
Le phénol est corrosif pour la peau à partir d’une concentration de 1 % ; instillé dans l’œil de lapin (solution aqueuse à 5 %), il induit une opacification non réversible de la cornée dont la durée et la sévérité sont amoindries par un lavage immédiat.
C’est un irritant respiratoire, la RD50 chez la souris est de 166 ppm.
Sensibilisation
Les tests de sensibilisation (Buehler chez le cobaye, épaississement de l’oreille (MESA) chez la souris) donnent des résultats négatifs avec des concentrations d’induction de 10 et 5 % respectivement.
Toxicité subchronique, chronique [1, 17]
Une exposition prolongée au phénol induit des effets d'intensité variable selon l'espèce, en particulier sur le système nerveux central, le cœur, le foie et les reins.
La létalité induite par le phénol est variable selon l’espèce et la voie d’administration :
- chez le rat, elle est importante par gavage (120 mg/kg/j, 14 j), plus faible à nulle par administration dans l’eau de boisson (360 mg/kg/j, 14 j ou 450 mg/kg/j, 103 sem) ou inhalation (0,1 - 0,2 mg/L, 90 j) ;
- chez la souris, aucune létalité après administration dans l’eau de boisson (375 mg/kg/j, 103 sem) ou inhalation (5 ppm, 90 j) ;
- chez le cobaye, détresse respiratoire et létalité importante après 20 jours d’exposition par inhalation (0,1 - 0,2 mg/L) avec modification du tractus respiratoire (inflammation, pneumonie, bronchite), du cœur (inflammation, dégénérescence et nécrose du myocarde, fibrose interstitielle), du foie (dégénérescence centrolobulaire et nécrose) et des reins (lésion du tube proximal et du glomérule) ;
- chez le lapin, un seul décès après 6 applications cutanées (783 mg/kg/j) ; par inhalation (0,1 - 0,2 mg/L, 88 j), les lésions sont semblables à celles du cobaye mais moins sévères.
Une baisse de poids corporel est induite chez le rat et la souris, exposés dans l’eau de boisson, par une baisse de prise d’eau et de nourriture.
Une exposition au phénol provoque des effets sur le système nerveux central ou périphérique des animaux, résultant en tremblements musculaires, mouvements incoordonnés transitoires, déséquilibre, hypothermie, diminution de l’activité spontanée et paralysie des membres antérieurs. Ces effets ne sont pas associés à des lésions morphologiques. Des applications intraneurales ou épidurales à fortes doses ont montré, chez le singe, le rat et le chat, un effet inhibiteur du phénol sur la conduction nerveuse et/ou une dégénérescence des axones et une démyélinisation de la moelle épinière et des nerfs distaux. La NOAEL pour les effets neurologiques est de 200 ppm dans l’eau de boisson du rat (18 mg/kg/j chez le rat mâle, 25 mg/kg/j chez le rat femelle).
Le phénol provoque chez la souris (6,2 mg/kg/j, 28 j dans l’eau de boisson) l’apparition d’une anémie par inhibition de l’érythropoïèse ainsi qu’une baisse de la réponse immunitaire ; cet effet n’a pas été étudié chez d’autres espèces.
Effets génotoxiques [1, 17]
Le phénol est mutagène in vitro pour les cellules de mammifère ; in vivo, il augmente légèrement le taux de micronoyaux dans les érythrocytes, à des doses toxiques uniquement.
In vitro, le phénol induit des mutations (faibles sur V79 et cellules de lymphome de souris, importantes sur cellules embryonnaires de hamster syrien), des aberrations chromosomiques (cellules ovariennes de hamster chinois), des micronoyaux (diverses cellules de mammifères), des échanges entre chromatides sœurs (lymphocytes humains, cellules ovariennes de hamster chinois en présence d’activateurs métaboliques) ainsi que l’induction de la synthèse non programmée de l’ADN (cellules embryonnaires de hamster syrien) ; en revanche, les résultats des tests bactériens et d’un test d’induction d’aneuploïdie (cellules embryonnaires de hamster syrien) sont négatifs.
In vivo, le test d’induction de micronoyaux dans les érythrocytes de souris après exposition unique par voie orale (265 mg/kg) donne des résultats faiblement positifs ou négatifs. Une injection intrapéritonéale (ip) à la même dose fournit des résultats positifs mais avec une forte cytotoxicité ; des injections intrapéritonéales multiples (jusqu’à 188 mg/kg) occasionnent des résultats faiblement positifs voire négatifs.
Le phénol n’induit ni aberrations chromosomiques dans la moelle osseuse du rat, après administration orale (510 mg/kg) ou injection intrapéritonéale (180 mg/kg), ni cassures de l’ADN testiculaire (79 mg/kg, ip). Il n’occasionne pas la synthèse d’adduits à l’ADN chez le rat ou la souris.
Effets cancérogènes [1, 19]
Le phénol n'est pas cancérogène dans les tests pratiqués par voie orale ou cutanée ; sur la peau, il agit comme promoteur après une exposition à des substances cancérogènes.
Administré par voie orale (2500 - 5000 ppm dans l’eau de boisson pendant 103 sem), le phénol n’est pas cancérogène pour le rat ou la souris ; une exposition cutanée (3 mg, 2 fois/sem, 20 sem) chez la souris provoque une inhibition de la croissance des poils et une irritation chronique de la peau mais pas de tumeurs.
Après traitement par le diméthylbenz[a]anthracène, inducteur de cancérogenèse, l’application cutanée de phénol (solution à 10 %, 2 fois/sem) augmente le taux de papillomes et de carcinomes cutanés. Le phénol, par son effet irritant, agirait comme promoteur au niveau de la peau.
Effets sur la reproduction [1, 20, 21]
Le phénol n'agit pas sur la fertilité des rats. Administré pendant la gestation, il est foetotoxique à des doses toxiques pour les mères.
Fertilité
Dans un test sur 2 générations, le phénol (200 - 1000 et 5000 ppm soit 15 - 70 - 300 mg/kg/j dans l’eau de boisson, 10 semaines avant accouplement, pendant l’accouplement, la gestation et la lactation), ne modifie pas les capacités reproductrices et la fertilité des rats des 2 sexes.
Développement
Le phénol administré par voie orale provoque, à une dose toxique pour les mères, une baisse de poids des petits à la naissance, l’apparition de fentes palatines chez la souris (280 mg/kg/j du 6e au 15e jour de gestation) et un retard d’ossification et de maturation sexuelle chez le rat (360 mg/kg/j par gavage du 6e au 15e jour de gestation ou 320 mg/kg/j dans l’eau de boisson sur 2 générations) mais pas d’effet tératogène.
| Espèce | NOAEL maternel | NOAEL fœtal |
| Rat | Gavage | 60 mg/kg/j | 120 mg/kg/j |
| Eau de boisson | 93 mg/kg/j | 93 mg/kg/j |
| Souris | Gavage | 140 mg/kg/j | 140 mg/kg/j |
Doses sans effet toxique observé pour le développement.
In vitro, le phénol, en absence d’activateurs métaboliques, n’a pas d’effet sur le développement de l’embryon de rat en culture jusqu’à la dose de 1 600 µM ; en présence d’activateurs métaboliques, la croissance et le développement des embryons sont inversement proportionnels à la dose à partir de 10 µM. Les métabolites du phénol présentent des effets embryotoxiques in vitro, sans apport d’activateurs métaboliques ; le plus toxique est l’aldéhyde t,t-muconique qui induit 100 % d’embryolétalité à 50 µM.